Résumé :
Depuis une dizaine d’années, des injonctions à la piété et à la réussite transforment les pratiques des musulmans sunnites. Ces injonctions créent des dynamiques économiques inédites d’offre d’objets-supports, de techniques et de formations qui circulent et s’insèrent dans un mouvement transnational. Débattus par différentes autorités et les fidèles, ces nouveaux usages s’accompagnent d’une production normative qui induit des accommodements. Cependant, ces nouvelles offres restent socialement invisibles car l’attention se concentre sur les radicalisations.
Ce programme propose d’analyser des « modernités plurielles » dans le sillage d’une croissance sans précédent du marché de la piété et de la réussite islamiques. Il se fonde sur les hypothèses A) que cette évolution est façonnée par une éthique de la réussite, B) que les matérialités constituent des supports moraux et C) qu’elles contribuent aussi à la fabrique des autorités religieuses et civiles.
Loin de souscrire à l’idée que ces manifestations participent d’une standardisation des pratiques, il s’agit de comprendre les profils sociologiques des musulmans concernés par ces offres et de voir si ces dernières reflètent des appartenances à des courants ou mouvances spécifiques de l’islam. Se pencher sur cette prolifération et sur les dynamiques plurielles de transformation, tout en tenant compte de leur historicité, permet d’appréhender ce qui est construit comme religieux, aussi bien du côté des autorités religieuses et des croyants, que des autorités civiles et de la société.
Ce projet de recherche propose une anthropologie à la croisée de la technique, de l’économie, du politique et du religieux. Mobilisant une ethnographie du quotidien et du détail dans les institutions islamiques sunnites (mosquées, associations, etc.), les entreprises et les familles en France – puis au Maroc et au Canada dans le cadre d’un programme international – il portera sur les matérialités : objets (jouets, vêtements, produits de beauté, stylet lecteur de Coran, etc.) et dispositifs de formation religieuse (techniques de développement personnel et pédagogies alternatives).
Mots-clés : islam, économie, matérialités, piété, Europe, Maghreb, Amérique
Profession de foi, bar-mitzvah et khâtima : rites familiaux, de passage et d’institution ?
Comparatisme des apprentissages religieux catholique, juif et islamique en contexte européen
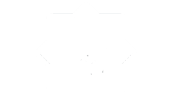
Résumé :
Mon doctorat sur les procédés de l’apprentissage religieux islamique a permis de faire ressortir l’articulation entre dogme, pratiques et éthique. Ces derniers se répondent en permanence et se manifestent socialement comme des savoirs : savoir-faire, savoir-dire et savoir-ressentir, acquis et transmis au quotidien. Ces résultats en contexte minoritaire posent la question de l’identité d’un croire spécifique. En effet, les divers procédés de transmission mis au jour ne sont sans doute pas particuliers à l’islam.
Dans la continuité de ce travail, je me propose donc d’effectuer une étude comparative qui interrogerait les catégories de construction des identités et de réaffirmation d’appartenances religieuses à partir de rituels d’apprentissage présents dans les trois monothéismes. La profession de foi catholique, la bar-mitzvah juive et le khâtima musulman clôturent l’apprentissage religieux de l’adolescent et marquent la fin d’un cycle de cours institutionnels d’instruction religieuse. Parallèlement, ces rituels sont l’occasion d’une fête familiale. La comparaison s’articulera sur deux questionnements, prenant en compte le récipiendaire. Comment l’adolescent inscrit cet événement dans sa vie ordinaire et sa vie de foi ? Et est-il un enjeu d’acquisition d’un statut au sein de la communauté pour la famille et pour l’autorité religieuse officiante ? Trois axes étaieront le comparatisme : les préparatifs rituels et festifs, la ritualisation de la cérémonie sous l’angle du triptyque officiant institutionnel, récipiendaire et famille, ainsi que les présents faits à cette occasion.
Me plaçant dans une approche anthropologique des apprentissages, je souhaite approcher cette expérimentation du croire, en travaillant sur les processus d’acquisition des savoirs religieux au moment où ils se réalisent. Il s’agira de comprendre comment ces moments rituels s’inscrivent dans un parcours du croire, mais aussi dans un environnement social plus large. C’est pourquoi ce projet interroge trois dimensions contemporaines du rite, comme rite familial, rite de passage et rite d’institution. C’est l’interaction de trois instances : famille, impétrant et institution, qui forme la teneur de ce rite dans des sociétés européennes, où Église et État, sont séparés. L’intérêt d’une telle recherche est de contribuer à une anthropologie des apprentissages, qui considère le jeune comme acteur à part entière dans son rapport au croire.
Deux points principaux étayent ma méthodologie. D’une part, les différents mécanismes d’intériorisation seront mis au jour par une attention portée aux détails, notamment ceux du « mode mineur de la situation » (A. Piette), comme révélateurs des fluctuations de l’intensité du croire de l’individu. D’autre part, je propose d’établir une chaîne opératoire séquençant les étapes qui composeraient le rite, dans une volonté de saisir l’instant cérémoniel comme éventuel rite de passage. Ce travail comparatif, à partir des trois monothéismes, permettra de rendre compte en même temps des processus collectifs d’apprentissage et des particularismes propres à chaque individu. Cette recherche pourrait déboucher sur une construction théorique sur les apprentissages religieux, au-delà des appartenances confessionnelles.








